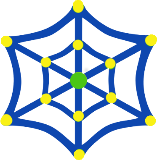Paul Lapie 1953
Bac 1953
J’ai passé mon bac en 1953, section Math Elem. Mais avant ça, je suis rentré en sixième en 1946, après avoir réussi le concours d’entrée.
Donc, en octobre, nous voici dans la cour du collège. Le Directeur, Monsieur Dussart, nous adresse une allocution de bienvenue où il nous dit entre autres choses oubliées depuis, que désormais nous faisions partie de l’élite. Puis M. Belloni, le surveillant général, nous expliqua qu’il fallait choisir sa langue vivante. « Que ceux qui veulent apprendre l’anglais fassent un pas vers la droite, les autres ne bougent pas » Tous sauf un font un pas vers la droite. Ennui de Belloni. Il nous explique alors que l’on aurait sans doute besoin d’officiers parlant l’allemand, en cas de conflit futur avec l’Allemagne (c’était en 46), et que par conséquent, il fallait que des élèves apprennent l’allemand. Donc, en colonne par un, et en avant. Quand on passait devant lui, on allait soit à sa droite (anglais) soit à sa gauche (allemand). Je suis tombé sur sa gauche. Comme en quatrième, il n’y avait que l’espagnol en seconde langue, j’ai dû apprendre l’anglais tout seul, pour parler avec mes collègues allemands, ce qui était plus pratique.
Quelques souvenirs : un jour, le peuple américain nous a envoyé des cadeaux, de la nourriture. Un élève avait reçu une boite d’ « oléo-margarine » et tous les élèves ont défilé dans la cour en monôme, en chantant « oléo, margarine, léo léo margarine, etc. » Sinon, en sixième, j’ai mangé à la cantine, et ce n’était pas joyeux. Il fallait apporter son pain, ses couverts, sa serviette. Heureusement, mes parents, l’année suivante m’ont jugé assez grand pour farire quatre fois le trajet à pieds. Les horaires, c’était 8 h — midi, deux heures — quatre heures, pour ne pas rencontrer les filles du collège d’à côté qui avaient une demi-heure de décalage. En 1948, nous avons commémoré le centenaire de la révolution de 1848 : exposition de dessins, spectacle, avec chorale (j’en étais) qui a chanté. Cela commençait par : « Par la voie du canon d’alarme » et ça finissait par « Mourir pour la patrie, c’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie ». Est-ce que cela pourrait se faire, maintenant ?
Les professeurs qui m’ont marqué : en sixième, M. Mathias. Il enseignait l’allemand et les maths. Ce devait être un ancien instituteur qui, en guise de promotion, avait le droit d’enseigner deux matières. Pour nous qui venions du primaire, cela a favorisé notre adaptation car il avait la technique des instituteurs. En allemand, ensuite, nous avons eu la même professeure jusqu’en première, Frau François. Ah, la Frau, ses cheveux blonds, ses gros yeux bleus ! ça a été comme une maman, pour nous. Encore en seconde, on se rappelait dans quel texte de quatrième, on avait vu tel mot.
En math, quelques noms demeurent : en cinquième, M. Pons. Il enseignait en férocité, comme un dompteur, toujours hurlant et nous traitant de nuls ! Un jour, il y avait sur l’estrade deux élèves paralysés, incapables de dire si oui ou non trois points quelconques pouvaient être alignés. Il se tourne vers moi et crie : Vedel ! et il répète la question : est-ce que trois points quelconques peuvent être en ligne droite ? Tremblant, et voulant sans doute lui faire plaisir je lui murmure en tremblant : » Oui, s’ils sont en ligne droite » . Ah, ce hurlement ! En troisième, nous avons eu, en math, M. Morin, dit Bicot, à cause de son crâne tout à fait semblable à celui du grand-père du Bicot de la bande dessinée. Lui, c’était la méthode froide et cruelle. Inventeur du zéro pointé (qui comptait double), du double zéro et du double zéro pointé (impossible de s’en relever, il en valait quatre), il nous demandait de rédiger nos devoirs d’algèbre au porte-plume (on avait déjà inventé le stylo, en 49), à l’encre noire, énoncé : écriture droite, solution : écriture penchée. Pour la géométrie, c’était l’inverse et attention au double zéro si on se trompe ! Malgré cela, on devait l’aimer, parce qu’on s’était cotisés pour lui faire un cadeau en fin d’année (un calendrier perpétuel, pour qu’il pense à nous). Malgré ces excès, je me demande si son action n’a pas été, en fin de compte, bénéfique. Nous sortions d’une quatrième complètement déjantée. Une expérience pédagogique avait supprimé les notes et le prof de math était absolument incapable de maîtriser sa classe. Pour faire court, nous n’avions rien fichu et Bicot a dû nous faire remonter la pente.
Mais les deux meilleurs profs de math ont été M. Parrod et M. Albessard (1ère et Math Elem). Parrod, en première. Grand fumeur de Lucky Strike, les doigts jaunis, il était du genre génial, sachant faire découvrir les beautés d’un raisonnement ou d’une astuce mathématiques. Un soir, il nous emmena voir les planètes à la Maison des Astronomes, rue Serpente, à Paris. Albessard, lui, était du style méthodique et travailleur, donnant les techniques pour résoudre n’importe quel problème. Vraiment deux bons profs, à mon avis.
En sciences naturelles, M. Thouraud. Un original, celui-là. En travaux pratiques, avec mon binôme, François, nous étions en train de tripoter le microscope pour essayer de sortir quelque chose de l’image trouble que nous apercevions, lorsqu’il surgit derrière nous, nous pousse, regarde dans la machine et s’écrire « Formidable ! » et se met à nous dessiner toute la coupe, d’une tige je crois, une hauteur de page, mieux que dans le livre. Nous, on recopie et la semaine d’après, on voit qu’il nous a collé un zéro avec comme commentaire « Impossible que vous ayez vu cela! ». Thouraud, c’était l’homme qui interrogeait au hasard, en fermant les yeux et en piquant un crayon sur sa liste. Mais avant, on le voyait mettre son doigt gauche juste devant le nom de celui qu’il voulait interroger.
Enfin j’aurai aussi un commentaire pour le professeur de physique, M. Montlaur. Pendant son premier cours de chimie, il nous a raconté une histoire de mercure et d’oxygène et en réalité, l’expérience de Lavoisier sur la détermination de la composition de l’air, fondatrice e la chimie moderne. Il nous a initiés à l’expérimentation scientifique : nous avions fabriqué des calorimètres avec des boites de conserve, étudié les moments des forces avec des barres de meccano, un tas de petites expériences pour nous donner l’idée de la manière dont on pouvait analyser le monde extérieur. Pour le cours sur les tuyaux sonores, il avait apporté son aspirateur pour souffler. Malheureusement, il faisait plus de bruit que les tuyaux et nous n’entendions rien.
Quelques autres noms marquants : M. Albouy, prof de français en première ; M. Mouillart, d’histoire géo en troisième ; M. Morhange, prof de philo, celui qui sortait une astuce toutes les vingt minutes et qui ne préparait pas ses cours (c’est une vacherie, certains l’adoraient mais pas moi). En gymnastique : Pangrani, dont Louis Vallée a rappelé ailleurs son « Je veux entendre le silence ». N’oublions pas non plus son « J’en entend qui ne chantent pas ». M. Unia, professeur d’histoire, qui nous a initié à la politique internationale avec son « D’où grande colère des Anglais ».
Les professeurs, c’était important (je m’aperçois que nous n’avons eu qu’une professeure, Frau François), mais il faut aussi parler de l’encadrement. Les pions, qui surveillaient quand les profs étaient absents, des étudiants sans doute.
Le surveillant général, M. Belloni. Un homme qui n’abusait pas de sa position et qui savait faire régner la discipline sans punir, ou en punissant rarement. Et les directeurs. M. Dussard, mort d’une crise d’urémie en 1948 ou 1949 (il n’y avait pas de rein artificiel), qui, nous a-t-on dit, s’était battu pour obtenir des classes de terminale dans ce collège de banlieue et surtout M. Chrétien qui a été principal pendant nos dernières années de présence au collège. C’était un homme qui aimait son métier et qui aimait ses élèves. En fin de scolarité, il a orienté beaucoup d’entre nous vers des carrières scientifiques. Sans ses conseils, je n’aurais jamais eu l’idée (et encore moins mes parents) d’aller au lycée Chaptal pour y préparer le concours d’entrée à l’École de Physique et Chimie de Paris. Ou je suis d’ailleurs entré pour ensuite faire une carrière au CNRS. Mais ceci est une autre histoire.